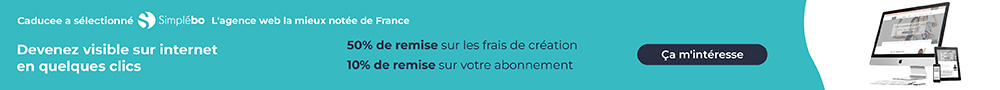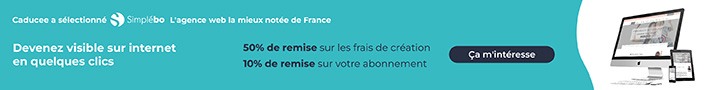Congés maladie : deux réformes, des impacts à géométrie variable

Deux mesures en parallèle : privé et public dans le viseur
Deux décisions gouvernementales distinctes mais complémentaires, appliquées en 2025, modifient les modalités d’indemnisation des arrêts maladie. Toutes deux s’inscrivent dans une même logique de maîtrise budgétaire, mais leurs publics cibles diffèrent.
La première concerne les salariés du secteur privé : elle abaisse le plafond des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie. La seconde, issue de la loi de finances, réduit de 10 % l’indemnisation des arrêts de courte durée dans la fonction publique.
Les externes et internes en médecine ont été inclus dans ce second dispositif, bien qu’ils ne soient pas des fonctionnaires à proprement parler, déclenchant une mobilisation immédiate de leurs représentants.
En toile de fond, ces deux mesures traduisent un recentrage progressif de la protection sociale sur les publics les plus couverts, laissant en retrait les statuts moins organisés.
Un plafonnement pour les salariés, amorti par la prévoyance
Dans le régime général, le plafond des indemnités journalières passe de 1,8 à 1,4 Smic. L’indemnité maximale chute ainsi de 53,31 € à 41,47 € brut par jour. Pour les salariés en dessous de ce seuil, l’indemnisation reste inchangée. En revanche, les plus hauts salaires peuvent subir une perte allant jusqu’à 250 € par mois.
Cette baisse est en grande partie compensée par les régimes de prévoyance complémentaire, désormais largement répandus. Ces dispositifs, obligatoires pour les cadres et présents chez 85 à 90 % des non-cadres, atténuent l’impact immédiat pour les salariés concernés.
À moyen terme, les experts anticipent une hausse des cotisations d’environ 2 %. La répartition de cette hausse dépend des négociations internes aux branches professionnelles.
Des protections inégales selon les statuts
Les professionnels libéraux : à l’écart mais toujours exposés
Les professionnels de santé en libéral (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ne sont pas concernés par cette réforme, relevant de régimes spécifiques gérés par des caisses autonomes comme la CARMF ou la Carpimko. Cette indépendance les maintient hors du champ de la réforme actuelle, mais ne les protège pas pour autant : les garanties restent limitées, et les arrêts de travail peuvent rapidement fragiliser leur revenu.
Les précaires : première ligne de vulnérabilité
Les salariés précaires – intérimaires, saisonniers, aides à domicile ou titulaires de CDD courts – sont parmi les plus exposés. Le manque fréquent de couverture complémentaire signifie qu’une baisse de l’indemnisation peut avoir des effets immédiats et marqués sur leur niveau de vie dès qu’ils dépassent le seuil de 1,4 Smic.
Les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle, régis par un autre dispositif, ne sont pas concernés par cette mesure.
Les étudiants en médecine en première ligne de la contestation
L’Association nationale des étudiants en médecine de France (Anemf) a vivement réagi à l’inclusion des externes et internes dans la baisse de 10 % des indemnités maladie de courte durée, une mesure prévue pour les agents publics. Pour l’organisation, cette extension n’a de sens que si elle s’accompagne d’une véritable égalité de traitement.
Le 17 mars 2025, l’Anemf a lancé une pétition qui a réuni plus de 4 400 signatures en 24 heures. Elle y formule plusieurs revendications : revalorisation des frais de transport et d’hébergement, inclusion dans les hausses de rémunération accordées aux hospitaliers, et alignement de leur rémunération sur celle des autres stagiaires de l’enseignement supérieur.
Leur mobilisation illustre une réaction plus large face aux effets d’une politique de rigueur budgétaire qui ne ménage pas les acteurs en formation.
Une logique d’économies à effets différenciés
Ces réformes marquent la poursuite d’une politique de réduction des dépenses sociales, amorcée fin 2024. Elles déplacent progressivement la charge financière de l’Assurance maladie vers les employeurs et les complémentaires santé.
Tandis que les salariés bénéficiant d’une protection collective solide en ressentent peu les effets immédiats, les publics précaires ou non couverts, ainsi que les étudiants, apparaissent plus exposés. Quant aux professionnels libéraux, bien que non concernés par ces mesures, ils restent confrontés à des lacunes de protection en cas d’arrêt de travail.
Ces ajustements techniques questionnent plus largement l’évolution du modèle de solidarité, entre montée en puissance de la logique assurantielle et persistance d’inégalités statutaires.
Sources : Le Parisien, BFMTV, Capital, CFTC, Village de la justice, Loi de financement de la sécurité sociale 2025
Descripteur MESH : Maladie , Statuts , Médecine , Étudiants , Travail , Logique , Politique , Rémunération , Santé , France , Face , Sécurité , Sécurité sociale , Ménage , Revenu , Médecins , Kinésithérapeutes , Infirmiers , Vie , Secteur privé , Mars