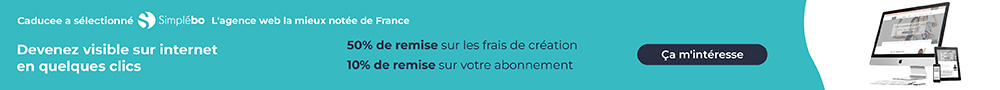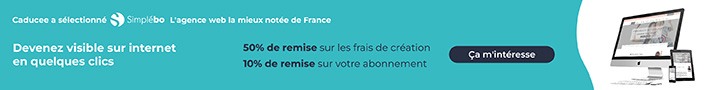L’État acte la primo-prescription des IPA

Une avancée réglementaire issue de la loi Rist 2
L’arrêté relatif à la primo-prescription, publié dans le sillage du décret du 20 janvier 2025 et formalisé par l'arrêté ministériel du 25 avril 2025, concrétise une mesure prévue par la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023, dite loi Rist 2. Ce texte autorise désormais les IPA à prescrire de manière autonome ou encadrée certains produits de santé et prestations, selon leur domaine d'intervention.
Les listes officielles, intégrées dans les annexes VI et VII de l'arrêté du 18 juillet 2018 modifié, précisent les produits concernés. Parmi eux : arrêt de travail jusqu'à 3 jours, transports sanitaires, antihypertenseurs ou encore antibiotiques sous conditions. Certains actes ne requièrent pas de diagnostic préalable, comme l’initiation d’un traitement pour une cystite simple ou une angine streptococcique, tandis que d’autres restent soumis à une concertation médicale.
Ce que peuvent désormais prescrire les IPA
-
Sans diagnostic préalable : antihypertenseurs de première ligne (hors bêtabloquants), traitements de première ligne du diabète de type 2, hydroxyzine, correcteurs du syndrome extrapyramidal, polygraphie ventilatoire, dispositifs d'auto-surveillance de la glycémie.
-
Avec diagnostic médical préalable : statines, insulines, bronchodilatateurs, oxygénothérapie, traitements addictologiques, antiémétiques, dispositifs d’aide au maintien à domicile, etc.
Ces prescriptions ne peuvent être renouvelées qu’en lien avec un médecin.
L’UNIPA, syndicat représentatif des IPA, salue cette reconnaissance réglementaire comme un jalon décisif dans la structuration de la profession. Cette évolution confirme la légitimité des compétences acquises par les IPA au cours de leur formation clinique avancée.
Une pratique intégrée, pas une autonomie isolée
Loin d’un modèle d’autonomisation sans filet, cette nouvelle prérogative s’inscrit dans un cadre coordonné. L’IPA pourra initier une prescription, tout en restant en lien étroit avec les médecins. Le principe de concertation reste central, notamment pour les renouvellements, afin de garantir une prise en charge globale et cohérente des patients.
L’UNIPA insiste sur la dimension collective de cette avancée : il s’agit de mieux mobiliser les compétences dans une logique de complémentarité. Cette organisation vise à fluidifier les parcours de soins et à répondre plus efficacement aux enjeux de démographie médicale.
« La primo-prescription n’est pas une autonomie déconnectée, mais une pratique avancée assumée. Elle valorise une dynamique collective, où chacun apporte sa pierre à l’édifice de la santé publique. » — UNIPA
L’entrée en vigueur de cet arrêté suppose des ajustements dans les pratiques des structures de soins. Les établissements devront intégrer les nouvelles missions des IPA dans leurs protocoles, organiser les outils de traçabilité des prescriptions et garantir un accès équitable à la formation continue. Ce changement organisationnel pourrait aussi favoriser une meilleure attractivité des postes en soins primaires ou en secteur sous-doté.
Une évolution qui ne fait pas consensus
Si l’arrêté constitue une étape importante, il ne ferme pas la porte à des évolutions bien au contraire. L’UNIPA indique qu’un travail de fond est engagé pour affiner et enrichir la liste des produits concernés par la primo-prescription. L’objectif est de coller davantage aux réalités de terrain, en ajustant le périmètre aux besoins observés dans les pratiques courantes.
Cette volonté d’élargissement ne fait toutefois pas l’unanimité et suscite des réserves et des tensions.
La Haute Autorité de Santé (HAS), dans un avis rendu en août 2024, a mis en garde contre une autonomie excessive dans la primo-prescription des IPA. Elle insiste sur la nécessité d’une formation renforcée et d’une actualisation du code de déontologie pour garantir la qualité et la sécurité des soins. L'institution juge que la prescription initiale de certains traitements, notamment pour des pathologies chroniques stabilisées ou des médicaments à risque (antibiotiques, codéine), ne devrait être envisagée qu'à titre exceptionnel et dans un cadre strictement encadré.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM) s’oppose également à la mise en œuvre de ces textes. Dans un éditorial publié en juillet 2024, son président, le Dr François Arnault, dénonce une atteinte au "contrat moral" liant l'État à la profession médicale. Il estime que "le Gouvernement va au-delà de la loi" en attribuant aux IPA des compétences non prévues par le texte législatif initial, notamment en matière de primo-prescription sans diagnostic médical préalable. Le CNOM envisage d'engager tous les recours légaux possibles pour obtenir la révision de ces textes, invoquant un risque pour la sécurité des soins confiés à des professionnels sans formation médicale complète.
L'Union française pour une médecine libre (UFMLS) a également exprimé son opposition. Dans un communiqué du 20 juillet 2024, le syndicat accuse les autorités de procéder à un "vol en bande organisée des actes médicaux", sans réelle concertation avec les représentants de la profession. Il affirme qu'il soutiendra les actions du CNOM pour défendre les prérogatives des médecins face à ce qu'il considère comme un transfert unilatéral de compétences.
Les freins institutionnels, organisationnels et financiers demeurent
L'absence de consensus et les réserves réglementaires ne constituent pour autant pas le principal frein à cette réforme. D'autres obstacles persistent : l’harmonisation des pratiques entre régions, la reconnaissance effective dans les systèmes d’information partagés, ou encore la nécessité d’une intégration rapide dans la convention nationale par la CNAM. Sans ces leviers, le potentiel de la primo-prescription pourrait rester partiellement inexploité.
Sans parler de la rémunération, qui est, disons-le clairement, peu incitative voire contre-productive en termes d’attractivité pour les IPA. D'après une consultation menée en 2025 par l'UNIPA, seuls 5,5 % des IPA se disent satisfaits de leur salaire. Les écarts de rémunération par rapport aux infirmiers diplômés d’État sont jugés trop faibles, et les modalités d’intégration ou de valorisation varient selon les statuts. Cette précarité relative alimente une inquiétude sur la fidélisation des professionnels et la pérennité du dispositif.
Ce constat renvoie une fois de plus à la difficulté persistante de la classe politique à rendre les métiers de la santé attractifs. Alors que les besoins en soins ne cessent de croître, la reconnaissance statutaire, la rémunération et les conditions d’exercice restent en décalage avec les attentes des professionnels. L’enjeu dépasse les IPA : il s’agit de restaurer une confiance durable entre les soignants et les décideurs publics, condition sine qua non pour assurer la stabilité et la performance du système de santé dans son ensemble.
Descripteur MESH : Soins , Infirmiers , Expertise , Santé , Diagnostic , Rémunération , Médecins , Antihypertenseurs , Travail , Risque , Sécurité , Déontologie , Conseil , Logique , Transports , Patients , Statuts , Formation continue , Politique , Gouvernement , Démographie , Éditorial , Antiémétiques , Cystite , Diabète , Diabète de type 2 , Syndrome , Codéine , Hydroxyzine , Insulines , Glycémie , Médecine , Bronchodilatateurs , Oxygénothérapie , Consensus , Confiance , Moral , Transfert , Face