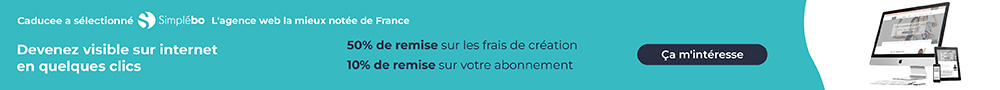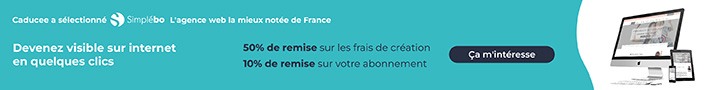PPL Garot : les médecins au bord de la rupture

Les syndicats dénoncent une attaque frontale contre la médecine libérale
L’adoption de la régulation par 155 voix contre 85 a provoqué une levée de boucliers sans précédent. L’UFMLS évoque « une insulte faite à tous les médecins » et appelle à une mobilisation unitaire, logistique et financière des internes, externes et praticiens.
Le Syndicat des Médecins Libéraux (SML) affirme que « le divorce est consommé » entre députés et médecins. Dans un communiqué virulent, il accuse les parlementaires de vouloir « détruire la médecine libérale » en s’appuyant sur des « chiffres erronés et des poncifs éculés », et alerte sur une prise de pouvoir des ARS au profit d’un modèle de médecins salariés à horaires fixes.
De manière inédite, l’ensemble des structures représentatives (MG France, CSMF, FMF, Avenir Spé, Jeunes Médecins, ISNI, ISNAR-IMG, ANEMF...) a signé un texte commun dénonçant la perte de la liberté d’installation et la méconnaissance des réalités du terrain. Ils rappellent que « 97 % des secteurs de garde sont couverts » et que « l’accès aux soins ne se décrète pas par décret ».
Une défiance généralisée vis-à-vis des autorités
Le ministre délégué à la santé, Yannick Neuder, a exprimé dès le départ son opposition à la mesure, soulignant qu’« une pénurie régulée reste une pénurie » et mettant en garde contre les effets contre-productifs : déconventionnements, départs à l’étranger, perte d’attractivité. Il plaide pour des solutions fondées sur la concertation et l'incitation.
Or, c’est précisément cette concertation qui fait défaut, selon les syndicats. L’ensemble des représentants de la profession déplore une loi « imposée d’en haut » sans consultation réelle des acteurs de terrain. L’UFMLS, MG France, la CSMF, le Conseil de l’Ordre ou encore les associations d’étudiants pointent une méthode unilatérale, éloignée du dialogue prôné par le gouvernement.
Le paradoxe est souligné par de nombreux responsables syndicaux : alors que Yannick Neuder a été missionné par François Bayrou pour conduire un cycle de concertations tout au long du mois d’avril, le vote précipité de l’article premier est perçu comme un acte de défiance à l’égard de cette démarche. Le ministre lui-même a reconnu que cette adoption risquait de « couper les discussions » en cours, compromettant la possibilité d’un compromis construit.
En parallèle, le Premier ministre François Bayrou a semblé valider la logique d’une régulation dans un discours prononcé le 1er avril. Une position que beaucoup dans le monde médical considèrent comme un reniement. Plusieurs syndicats, dont l’UFMLS, accusent l’exécutif de populisme électoral, estimant que « ce n’est pas du courage politique, mais du populisme maquillé en solution ».
Le cri d’alarme des praticiens de terrain
Au-delà des syndicats, de nombreux médecins s'expriment directement sur les réseaux et dans les médias professionnels, livrant des témoignages personnels, souvent marqués par la lassitude, l'indignation ou la colère froide.
Fabien interroge : « Pourquoi faire encore médecine ? Plombier, installateur de climatiseur… leur secteur 2 existe, et surtout la liberté d’installation. » Il évoque la possibilité pour les médecins de créer leur propre secteur 3, comme ultime espace de liberté.
Camille dénonce une politique qui ne fait que dégrader encore davantage l’attractivité du métier : « Ou comment rendre ce magnifique métier (difficile mais vital) encore moins attractif pour les jeunes !! Quel désastre !! »
Xavier, jeune médecin généraliste installé depuis trois ans, fait le constat amer d’une situation de plus en plus intenable : surcharge, contraintes administratives croissantes, perte de sens. Il appelle à des formes de mobilisation alternatives à la grève, avec des propositions concrètes :
-
repos systématique après une garde,
-
passage aux 35h de consultation par semaine,
-
application de dépassements exceptionnels pour demandes non urgentes ou confort,
-
tarification renforcée pour les visites à domicile non justifiées médicalement.
Selon lui, ces actions seraient plus efficaces que les grèves ponctuelles, peu soutenables pour des libéraux : « Il est temps de rétablir un rapport de force avec nos élus. »
Enfin, Laurent, médecin en fin de carrière, témoigne de son usure psychologique après une vie de disponibilité : « J’ai sacrifié ma famille pour un système en déclin. Si la garde devient obligatoire, j’arrête. Je vivrai sur mes économies. Mais je n’y laisserai pas ma peau. »
Ces paroles, du quotidien et du terrain, traduisent une rupture émotionnelle profonde entre la profession et ses décideurs. Elles révèlent un climat d’abandon et de colère contenue, où la médecine n’est plus perçue comme un engagement mais comme un piège.
« Il est temps de rétablir un rapport de force avec nos élus. »
Le sentiment dominant dans les cabinets est celui d’un profond découragement. Les jeunes médecins dénoncent une pression croissante, des conditions de travail dégradées, un système de plus en plus complexe. Le chiffre choc relayé par l’UFMLS est sans appel : un interne se suicide tous les 18 jours.
Selon les données partagées dans les réactions syndicales :
-
21 % des étudiants abandonnent leurs études en cours de médecine,
-
seulement 9709 médecins se sont installés en libéral exclusif sur 66 000 diplômés en dix ans,
-
5000 médecins ont quitté la France,
-
87 % du territoire est concerné par des difficultés d’accès aux soins.
Ces chiffres contredisent, selon eux, les intentions du texte, qui prétend améliorer la couverture médicale mais ne ferait qu’accroître la désaffection pour l’exercice libéral.
La CNAM est réservée
Dans un entretien accordé au Quotidien du Médecin le 3 avril, Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), a exprimé ses propres réserves sur la régulation à l’installation. Bien qu’il reconnaisse l’importance du sujet des déserts médicaux, il déclare clairement : « J’ai des interrogations sur des mécanismes coercitifs, compte tenu de leur démographie. »
Il souligne que la situation des médecins diffère de celle d’autres professions de santé, comme les kinésithérapeutes ou les infirmiers, pour lesquels des dispositifs de régulation ont déjà été mis en place avec la Cnam. Pour les médecins, il insiste sur la nécessité d’adapter les outils à la réalité du terrain et de veiller à ce que « le remède ne soit pas pire que le mal ».
Sur la question du retour d’une permanence des soins obligatoire, également prévue dans la PPL Garot, il partage les réserves du ministre, rappelant que « 97 % des territoires de garde sont couverts » et que le volontariat fonctionne. Il s’oppose à toute obligation généralisée qui risquerait de produire l’effet inverse.
Concernant la démographie médicale, il se montre très prudent sur les appels à limiter le nombre de médecins formés, estimant au contraire qu’il faudra « faire face à une demande croissante liée au vieillissement de la population et à l’augmentation des pathologies chroniques ».
Enfin, il souligne que la transparence sur l’accès aux soins progressera dans les mois à venir grâce à la mise en ligne d’indicateurs open data. Mais il rappelle que la convention médicale repose sur l’engagement collectif, et non sur une logique de contrôle individuel.
Une charge contre l'idéologie de la régulation
Au-delà des réactions syndicales et politiques immédiates, certains experts remettent en cause les fondements mêmes de la régulation envisagée. L’économiste de la santé Frédéric Bizard dénonce dans une tribune récente une série de « sophismes » qui, selon lui, minent la réflexion sur les déserts médicaux.
Il rejette notamment l’idée que la démographie médicale se corrige par une gestion centralisée. Pour lui, la médecine libérale a historiquement permis une couverture territoriale plus efficace que ne le feraient des mesures administratives de type autorisation d’installation. Il y voit un glissement idéologique vers un modèle bureaucratique inefficace, qui risquerait d’aggraver la situation actuelle.
Frédéric Bizard considère également que la régulation est techniquement inapplicable et symboliquement contre-productive. Il plaide pour une réforme de fond du système de santé, articulée autour d’un cadre contractuel rénové, d’une gouvernance décentralisée, et d’un soutien assumé à l’exercice libéral, perçu comme un vecteur d’innovation et de résilience.
une « France sans médecins » ?
La régulation votée par l'Assemblée marque plus qu'un tournant législatif : elle ouvre une fracture profonde entre la représentation politique et les soignants de terrain. En contournant les mécanismes de concertation pourtant mis en avant par le gouvernement, le texte fragilise encore davantage un pacte déjà distendu.
Alors que les prochaines étapes législatives s'annoncent encore plus sensibles – obligation de gardes, encadrement du secteur 2, limitation des remplacements – les tensions risquent de s'aggraver. Le mois de mai pourrait être un point de bascule. Soit le dialogue est rétabli, soit le fossé s'élargira. Et avec lui, le risque d’un désengagement massif d’une profession déjà éprouvée.
Le vote de l’article premier, à 23h50 dans un hémicycle clairsemé, cristallise le ressentiment d’une profession déjà sous pression. Les signataires du texte commun, parmi lesquels le Conseil national de l’Ordre des médecins et plusieurs représentants d’élus locaux, accusent les députés d’avoir « ignoré les professionnels de santé, les réalités démographiques et la parole du terrain ».
Pour ces organisations, seule une politique fondée sur l’écoute et l’incitation, accompagnée d’un choc d’attractivité sur la formation, l’installation et les conditions d’exercice, pourra freiner la spirale de la désaffection. Faute de quoi, préviennent-elles, « une France sans médecins » deviendra une réalité.
Descripteur MESH : Médecins , France , Syndicats , Gouvernement , Colère , Rupture , Face , Confiance , Médecine , Santé , Soins , Politique , Liberté , Démographie , Logique , Conseil , Pression , Temps , Choc , Économies , Infirmiers , Kinésithérapeutes , Solutions , Population , Professions , Étudiants , Maladie , Grèves , Permanence des soins , Discours , Entretien , Peau , Vie , Travail , Divorce , Adoption , Démarche , Risque , Suicide , Parole , Professions de santé , Climat , Voix , Vieillissement , Famille