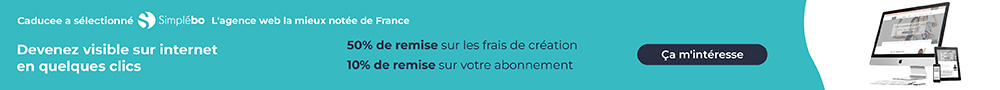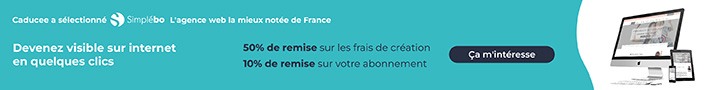La santé est politique : repenser la médecine face aux discriminations systémiques du monde médical

Une médecine prétendument universelle, mais inégalitaire dans les faits
« La médecine soigne-t-elle vraiment tout le monde ? » La question posée en sous-titre du livre de Miguel Shema prend le contre-pied d’un consensus largement répandu en France. Grâce à la Sécurité sociale et à la carte Vitale, l’égal accès aux soins semble assuré. Pourtant, selon l’auteur, cette croyance masque une réalité bien plus nuancée. Étudiant en cinquième année de médecine, mais aussi formé à la sociologie, Miguel Shema décrypte les mécanismes sociaux qui traversent la pratique médicale et en altèrent l’équité.
Son livre s’appuie sur des recherches scientifiques, ses observations de terrain lors de stages hospitaliers ou en cabinet, et sa propre expérience de jeune homme racisé dans un univers majoritairement blanc et bourgeois. Ce croisement des regards lui permet de mettre en évidence les écarts de traitement liés à l’origine sociale, au genre, à la race, à l’orientation sexuelle ou au statut administratif.
À travers un ensemble de situations concrètes — un patient sans papiers qui ne peut suivre son parcours de soins, une femme noire dont la douleur est minimisée, un patient LGBTQ jugé dans sa sexualité —, l’auteur montre comment les inégalités structurelles du monde social pénètrent l’univers médical. « Le regard du clinicien n’est pas neutre », affirme-t-il. Il est façonné par des normes implicites, des routines d’enseignement, des discours souvent non remis en question.
Des préjugés raciaux persistants aux effets cliniques durables
L’un des biais les plus documentés est la supposée moindre sensibilité à la douleur chez les personnes noires. Cette croyance, encore répandue dans les services hospitaliers selon Shema, conduit à des erreurs d’évaluation, et donc à une moindre administration d’antalgiques. Des travaux ont d’ailleurs montré que, pour une situation clinique identique, les patients noirs reçoivent moins de traitements antalgiques que les patients blancs, y compris les enfants.
Autre exemple : le fameux « syndrome méditerranéen ». Présenté dans certaines formations comme un trait culturel, il désigne un supposé penchant des patientes maghrébines ou africaines à exagérer leurs douleurs. Hérité de l’époque coloniale, ce stéréotype continue de faire son chemin, justifiant des décisions de soins différenciées.
Les femmes roms, quant à elles, sont souvent perçues comme ayant des comportements reproductifs irresponsables. « Il y a cette croyance que les femmes roms ont des taux de fécondité et d’IVG élevés en raison de leur culture “arriérée” et patriarcale. La réalité est tout autre : elles ont en réalité moins accès, entre autres, à la contraception », déclare Miguel Shema (Mediapart, 13 avril 2025). Loin d’être fondées, ces représentations traduisent surtout un mépris de classe et une ignorance des obstacles à l’accès à la contraception. Plus largement, Shema rappelle que les consultations avec les personnes issues des classes populaires sont souvent plus courtes, moins pédagogiques, et marquées par un langage technique inadapté.
Une médecine sourde aux réalités sociales
Le rejet ou l’ignorance de la complexité des trajectoires de soins apparaît comme un trait récurrent. L’auteur évoque ainsi le cas d’un patient sans-papiers, blessé à la main, qui n’a pas pu se rendre à la clinique spécialisée par manque de temps et de ressources. L’attitude des soignants — condescendante, agacée — illustre, selon Shema, l’incompréhension des contraintes matérielles vécues par certains patients. « Le rapport d’un patient à sa santé est la résultante de ses conditions d’existence », rappelle-t-il.
Pendant la crise du Covid, ces mécanismes se sont accentués. Dans les Antilles, la faible couverture vaccinale a été interprétée comme un signe d’arriération culturelle. Dans la Seine-Saint-Denis, les contaminations ont été imputées à une indiscipline supposée. Ces lectures culturalistes masquent des réalités structurelles : logements surpeuplés, métiers exposés, méfiance vis-à-vis des institutions issues d’une histoire coloniale ou sociale lourde.
Genre, sexualité et invisibilisation des identités
Miguel Shema consacre également une part importante de son analyse aux discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle. Les personnes LGBTQ sont nombreuses à rapporter des expériences de jugement, d’incompréhension, voire de refus de soins. L’accès à la PrEP ou à certains examens spécialisés reste difficile. Des praticiens projettent sur leurs patients des représentations hétéronormées : un proctologue peut ainsi recommander à un homme homosexuel de « faire l’amour normalement », au lieu d’examiner la plainte avec neutralité.
Les biais transphobes et intersexophobes sont également présents. La médecine, écrit Shema, a longtemps cherché à définir ce qu’est « un vrai homme » ou « une vraie femme », au mépris des vécus individuels. Certaines pratiques médicales sont ainsi restées longtemps modelées par des normes biologiques binaires, au lieu d’accompagner les personnes dans leur singularité.
Une critique constructive pour transformer la formation médicale
Si le constat est sévère, l’intention est résolument constructive. L’auteur ne se contente pas de dénoncer, il plaide pour une refonte des cursus de formation. Les sciences sociales, estime-t-il, doivent être intégrées de manière plus structurelle dans les études de médecine. Les représentations des patients doivent être interrogées, les rapports de domination explicités.
Certains signaux positifs existent déjà. Des diplômes universitaires sur les questions de discriminations émergent, des enseignants comme la sociologue Priscille Sauvegrain interviennent dans les facultés, et des collectifs étudiants s’organisent. Mais selon Shema, l’essentiel reste à faire pour déconstruire un monde médical encore largement hermétique à l’analyse critique de ses propres pratiques.
En définitive, l'argument central de Miguel Shema est que la santé est fondamentalement politique : les soins médicaux ne peuvent être dissociés des structures sociales, des rapports de pouvoir et des inégalités qui traversent notre société. Reconnaître cette dimension politique est, selon lui, une étape essentielle pour construire un système de santé véritablement équitable et ancré dans la réalité sociale.
« La santé est politique » (Belfond, 2025) de Miguel Shema
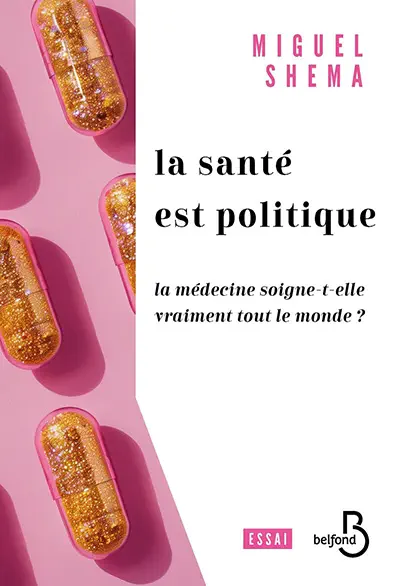
Descripteur MESH : Médecine , Politique , Santé , Face , France , Lecture , Lumière , Racisme , Homophobie , Soins , Patients , Personnes , Sexualité , Femmes , Douleur , Sécurité , Sécurité sociale , Services hospitaliers , Discours , Antilles , Fécondité , Histoire , Étudiants , Pied , Temps , Sociologie , Sciences sociales , Jugement , Signaux , Consensus , Langage , Contraception , Main