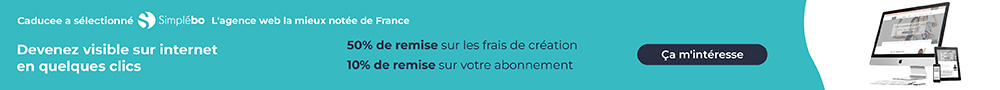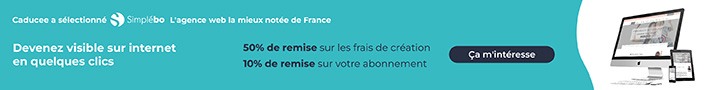Urgences 2013-2023 : plus d’actes, plus de patients, moins de capacité d’accueil

Un dispositif d’enquête renouvelé pour une photographie à dix ans d’intervalle
Réalisée en collaboration avec les professionnels des urgences, l’enquête Urgences 2023 s’est déroulée le mardi 13 juin, comme en 2013, sur une période de 24 heures. L’étude a porté sur 58 500 patients accueillis dans 719 points d’accueil des structures d’urgences générales et pédiatriques en France. Les urgences spécialisées (dentaires, psychiatriques, etc.) ne sont pas incluses.
Le jour de collecte a été volontairement choisi hors périodes de forte affluence (vacances scolaires, pics épidémiques), ce qui permet une comparaison rigoureuse avec les données de 2013. L’objectif : identifier les évolutions structurelles majeures dans les pratiques, les profils des patients et l’organisation hospitalière.
Un allongement généralisé de la durée de passage aux urgences
La durée médiane de passage aux urgences atteint désormais 3 heures, contre 2h15 en 2013. Un quart des patients reste plus de 5h30, et 15 % y passent plus de 8 heures. Cette hausse concerne tous les parcours :
-
Pour les 80 % de patients retournant à domicile sans hospitalisation ni UHCD, la durée médiane est de 2h30 (contre 1h50 en 2013).
-
Pour les 11 % hospitalisés hors UHCD, elle atteint 5h20 (contre 3h55).
-
Pour les 5 % passés en UHCD uniquement, elle grimpe à 14h50 (contre 12h30).
Une fréquentation accrue, portée par les extrêmes de l’âge
Le taux de recours aux urgences progresse à 0,9 ‰ (contre 0,8 ‰ en 2013). Il est particulièrement élevé chez les nourrissons (2,2 ‰) et les plus de 85 ans (1,5 ‰). L’âge moyen des patients augmente de 36,7 à 39,5 ans.
Les moins de 15 ans représentent désormais 23 % des passages (contre 27 %), tandis que les plus de 65 ans passent de 19 % à 22 %, en lien avec le vieillissement démographique.
Des obstacles croissants dans l’accès aux soins de ville
La moitié des patients sont orientés par un médecin ou transportés par un véhicule de secours. Toutefois, 21 % déclarent être venus faute de rendez-vous disponible ailleurs, un chiffre en forte hausse (14 % en 2013).
La densité des médecins généralistes ayant baissé, l’accès aux soins primaires s’est détérioré, accentuant le rôle de recours des urgences. Le Samu-SAS joue un rôle grandissant : 16 % des patients suivent ses recommandations (contre 7 % en 2013), notamment depuis les campagnes publiques incitant à composer le 15 avant tout déplacement.
Une prise en charge plus technique et plus lourde
Les examens et soins se diversifient :
-
45 % des patients reçoivent une imagerie, dont une part croissante de scanner ou IRM.
-
40 % bénéficient d’analyses biologiques (contre 35 % en 2013).
-
44 % reçoivent des médicaments, majoritairement des antalgiques.
Les personnes âgées sont les plus concernées par cette intensification : 94 % des plus de 75 ans ont reçu au moins un acte ou un traitement. Le recours à la voie intraveineuse ou aux examens complexes y est plus fréquent.
L’UHCD et l’hospitalisation, des dispositifs sous tension
L’unité d’hospitalisation de courte durée accueille 9 % des patients (22 % pour les 75 ans ou plus). Un quart d’entre eux n’a pas de lit dédié, et reste sur un brancard dans le service. Le passage par l’UHCD est souvent motivé par la surveillance ou l’attente d’examens complémentaires.
L’hospitalisation à la sortie des urgences diminue : 15 % des patients en 2023, contre 20 % en 2013. En cumulant UHCD et hospitalisations hors urgences, 20 % des patients sont concernés (contre 23 % en 2013). Ce recul touche toutes les tranches d’âge et pourrait s’expliquer par des changements de pratiques et par la réduction du nombre de lits hospitaliers (-11 % en dix ans, soit 43 000 lits en moins).
Une fois la décision d’hospitalisation prise, l’obtention d’un lit prend moins de 15 minutes pour la moitié des patients, mais dépasse 6 heures pour 10 % d’entre eux (contre 3h45 en 2013).
Des motifs de recours variables selon l’âge
Les trois principales causes de venue restent la traumatologie (un tiers des cas), la gastro-entérologie et les pathologies cardio-circulatoires. Chez les enfants, la fièvre, les troubles digestifs et respiratoires dominent. Entre 15 et 74 ans, les profils varient peu. Après 75 ans, les motifs se diversifient : chutes, affections cardio-vasculaires, altération de l’état général, asthénie, anomalies biologiques.
Un système de soins à réorganiser face aux besoins croissants
L’allongement des durées de passage, la montée en charge des services, la transformation des profils patients et les difficultés de coordination avec la médecine de ville renforcent les tensions sur les urgences.
Une meilleure articulation entre soins de ville, Samu-SAS, UHCD et hospitalisation s’avère nécessaire pour absorber la pression croissante. Mieux anticiper les besoins de lits, renforcer la régulation en amont et soutenir les professionnels hospitaliers constituent des priorités pour maintenir un accès fluide, sécurisé et équitable aux soins urgents.
Source : DREES, Études et Résultats n°1334, mars 2025
Descripteur MESH : Patients , Urgences , Soins , Photographie , Pression , Services hospitaliers , Lumière , Lits , Hospitalisation , Rôle , Déplacement , France , Médecins généralistes , Médecins , Personnes , Vacances , Traumatologie , Médecine , Vieillissement , Face , Mars , Fièvre , Asthénie , Joue