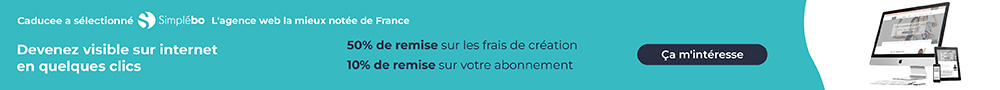La clause de conscience et l’IVG : ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué

Rappelons pour mémoire que depuis la Loi VEIL, aucun professionnel de santé ne pouvait être contraint de participer à une IVG s’il ne le souhaitait pas : le principe était la liberté de conscience.
À la faveur des modifications législatives successives et notamment depuis 2001, la clause de conscience était maintenue, mais une restriction (courte) lui était apportée en ce que le médecin qui refusait de pratiquer l’interruption de grossesse devait, sans délai, donner à la patiente les coordonnées d’un confrère.
On souligne que les chefs de service n’avaient plus la liberté de pouvoir invoquer la clause de conscience pour ne pas pratiquer l’IVG dans leur service, le Conseil constitutionnel ayant, à ce sujet, considéré que la liberté de conscience du praticien était sauve, puisque lui-même disposait de la faculté personnelle de ne pas pratiquer l’acte qui lui posait problème.
C’est donc cet état de droit que le législateur, en première lecture, a entendu supprimer, voulant marquer le coup en soulignant le caractère fondamental du droit à l’IVG qui ne saurait être entravé par une restriction de l’accès à celui-ci.
L’atteinte à la liberté de conscience est symbolique prenant la peine de souligner les députés porteurs de la proposition de loi, en ce que le code de déontologie médicale en son article R 4127-47 prévoit déjà celle-ci en ces termes :
« (…) Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
Aussi, soulignent-ils, la liberté de conscience du médecin demeure sauve !
Curieuse conception de la mission du législateur que de prendre des dispositions dont il reconnait lui-même au fond, qu’elles seraient sans aucune portée et donc inutiles !
Quoi qu’il en soit, qu’en est-il réellement ?
Que penser de cette proposition sur le plan juridique d’une part, et d’autre part, si celle-ci est confirmée par le sénat qu’en sera-t-il exactement de la liberté de conscience du médecin, de l’infirmier ou de la sage-femme ?
En premier lieu, il faut souligner que le coup de boutoir à la liberté de conscience en matière d’IVG est dans l’air du temps, depuis quelques années.
On lit sous la plume de Florence BELLIVIER, Professeur de droit à Nanterre, en 2018, une analyse tout à fait passionnante de cette clause et de sa raison d’être.
Pour le professeur :
« Politiquement, l’existence d’une clause de conscience, générale ou spéciale (pour un acte) — traduit deux choses : d’une part le caractère particulier de l’exercice médical qui met en relation un professionnel et une personne qui souffre ; d’autre part, le pluralisme de nos sociétés qui a pour conséquence que lorsqu’une technique ou une pratique autrefois illégale finit par être admise, c’est souvent sans unanimité, d’où la nécessité de passer par le dispositif liberté encadrée/clause de conscience individuelle également circonscrite. Par exemple, dans un autre champ que l’IVG, lorsque, par la loi du 4 juillet 2001, le législateur a admis la stérilisation à visée contraceptive, il a précisé qu’“un médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive”, mais qu’“il doit informer l’intéressée de son refus dès la première consultation” (art. L. 2123-1 al. 5 CSP) ».
Juridiquement le Conseil constitutionnel a reconnu la portée constitutionnelle de la liberté de conscience dans sa décision du 23 novembre 1977 sur la loi relative à la liberté d’enseignement. Il l’a rattachée, d’une part, à l’article 10 de la Déclaration de 1789 (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ») et, d’autre part, au cinquième alinéa du Préambule de 1946 (« Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances »).
Dans sa décision du 27 juin 2001 sur la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) justement, et à la contraception, le Conseil s’est prononcé sur les dispositions qui supprimaient le droit, pour un chef de service d’un établissement public de santé, de refuser que son service pratique des IVG tout en maintenant la possibilité pour les médecins et le personnel hospitalier de refuser de participer à ce type d’opérations. Le Conseil a jugé, après avoir rappelé le considérant de principe de la décision du 23 novembre 1977 :
« 15. Considérant que, si le chef de service d’un établissement public de santé ne peut, en application de la disposition contestée, s’opposer à ce que des interruptions volontaires de grossesse soient effectuées dans son service, il conserve, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, le droit de ne pas en pratiquer lui-même ; qu’est ainsi sauvegardée sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle (…) ».
Le Conseil constitutionnel a fondé, là encore, sa décision sur l’article 10 de la Déclaration de 1789 et le cinquième alinéa du Préambule de 1946. Il a jugé que « la liberté de conscience, qui résulte de ces dispositions, est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ».
Ainsi, est-il constant que la liberté de conscience, même si elle n’est pas absolue, comme en témoigne la décision relative aux chefs de service précités, est une liberté fondamentale et constitutionnellement garantie.
Et c’est ici que tout se complique pour le législateur, qui à force de vouloir faire des symboles en oublie de lire la constitution…
En effet, la circonstance que l’objection de conscience soit rattachée à l’article 10 de la DDHC et soit une garantie fondamentale, oblige le législateur à la protéger, à l’exclusion de toute autre autorité, quelle qu’elle soit !
C’est le sens même de l’article 34 de la constitution selon lequel :
« La loi fixe les règles concernant :
Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens.
La compétence du législateur n’est pas une option, mais une obligation dans les domaines que la constitution lui attribue tant et si bien que s’il méconnait l’étendue de sa compétence, il entache son texte d’une inconstitutionnalité et encourt donc la censure ».
Pour faire simple, on considère que les domaines les plus importants de la vie des citoyens doivent être soumis au vote de la représentation nationale, et tel est le cas pour les garanties fondamentales et les libertés publiques.
Le Conseil constitutionnel est attentif à ce que le législateur ne reporte pas sur une autorité administrative, notamment le pouvoir réglementaire, ou sur une autorité juridictionnelle le soin de fixer des règles ou des principes dont la détermination n’a été confiée qu’à la loi : c’est ce que l’on nomme l’incompétence négative laquelle est sanctionnée par le gardien de la constitution.
Or, dans le cas de la suppression de la clause de conscience dans le cadre de l’IVG, nous sommes exactement dans cette situation !
Le législateur a clairement entendu maintenir cette clause, puisqu’il s’agit d’une liberté fondamentale, mais a cru pouvoir se déposséder de sa compétence pour la garantir sur le pouvoir réglementaire, lequel l’a consacré au code de déontologie médicale, sous la forme d’une clause générale !
Outre le fait que décidément personne ne lit le code de déontologie médicale, sans quoi aurait été visé l’article R4127-18 qui prévoit une clause de conscience spécifique à l’IVG, il est clair que le parlement ne peut abandonner sa compétence à qui que ce soit : c’est à lui et lui seul qu’il appartient de protéger la liberté de conscience des médecins et le fait qu’un article du code de déontologie protège déjà celle-ci est totalement indifférent !
En d’autres termes : le code de déontologie peut reprendre une liberté garantie par la loi, mais ne peut pas la garantir ab initio.
Ainsi, la mesure de suppression est-elle bien un symbole ? Celui de l’incompétence de députés qui au nom de considérations bassement électorales ou politiques en arrivent à violer frontalement la constitution dont tout porte à croire, parfois, qu’ils en ignorent jusqu’à l’existence.
Le propos ne saurait être exhaustif si l’on ne se projetait pas dans l’hypothèse peu probable où députés et sénateurs ne saisiraient pas le Conseil Constitutionnel dans l’hypothèse où la suppression devait être entérinée en seconde lecture.
Alors, en effet, subsisterait pour l’IVG une objection de conscience uniquement prévue au code de déontologie…, mais sauf que celle-ci ne serait pas générale, comme le pensent les députés, mais bel et bien spécifique !
En effet, il reste un mystère de savoir pourquoi il est constamment évoqué l’article R4127-47, qui certes parle de l’objection de conscience générale, alors qu’existe un article R4127-18 qui dispose clairement :
« Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s’y refuser et doit en informer l’intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi ».
Cet article se divise en trois parties :
1) l’IVG sauvage ou hors délai est interdite,
2) le médecin peut refuser de pratiquer l’acte,
3) il doit informer l’intéressée dans les conditions prévues par la loi s’il refuse.
Or, cet article est bien moins exigeant pour les médecins que ne l’est actuellement la loi, puisque l’article L 2212-8 du Code de la santé publique (qui a vocation à disparaitre) dispose :
« Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2 ».
Le code de déontologie ne prévoit lui, aucune obligation de donner le nom d’un praticien susceptible de réaliser l’intervention… autrement que dans les conditions prévues par la loi.
Donc, si celle-ci ne prévoit plus rien, plus aucune obligation d’information ne pèse sur le médecin.
Et pour bien s’en convaincre, il suffit de regarder les commentaires sous l’article en question, et émis par l’Ordre national des médecins, qui indiquent :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse. Mais il doit informer sans délai l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom des praticiens susceptibles de réaliser l’intervention (voir note 8). Or, la note 8 est ainsi rédigée. [8] Article L.2212-8 du code de la santé publique ».
Ainsi, l’Ordre national confirme puissamment que si l’article législatif disparait, le médecin n’a plus aucune obligation d’information de la patiente, ni de transmettre les coordonnées de qui que ce soit !
Rappelons que tout ce chambardement législatif était censé garantir un accès à l’IVG plus simple et plus efficace !
C’est dire le niveau d’incompétence du législateur contemporain qui en arrive à voter des textes qui sont contraires à l’objectif par lui poursuivi et le tout s’en même s’en rendre compte et sans qu’aucun conseiller ou attaché parlementaire ne le lui souligne !
Décidément… triste époque pour l’État de droit.

SELARL DI VIZIO
130 bis avenue Charles de Gaulle,
92200 NEUILLY sur SEINE
Tél : 01 78 82 00 15
http://www.cabinetdivizio.com/
Descripteur MESH : Conscience , Liberté , Grossesse , Lecture , Conseil , Santé , Déontologie , Médecins , Caractère , Santé publique , Stérilisation , Contraception , Sociétés , Emploi , Femmes , Personnel hospitalier , Vie , Art , Travail , Droits civiques , Soins , Temps , Mémoire