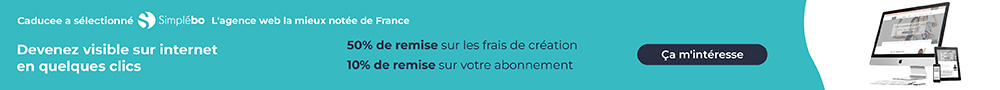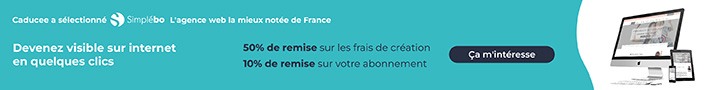Désinformation médicale : vers une politique publique coordonnée

Une réponse coordonnée face à un enjeu de santé publique
Parmi les facteurs déclencheurs de cette mobilisation, le ministre évoque les dérives observées à l’international. Il alerte notamment sur la dangerosité de figures publiques relayant des discours pseudoscientifiques, déclarant : « Si un Kennedy vous dit que la vaccination est dangereuse, qu’elle provoque l’autisme, il y a danger, car ce nom peut rassurer et inspirer confiance à une partie de la population. » Cette déclaration a été formulée dans un entretien accordé à L’Express, publié le 18 avril 2025.
Jusqu'à présent, la désinformation médicale ne faisait l'objet d'aucune politique publique structurée. Cette absence d'organisation a favorisé la circulation de contenus erronés, parfois dangereux, notamment sur les réseaux sociaux. Yannick Neuder, médecin cardiologue de formation, rappelle que ces discours nuisent directement à la prise en charge des patients. Il souligne qu'une telle dérive affaiblit la confiance dans les institutions, alimente le populisme et nuit à la cohésion sociale. Le ministre plaide pour une mobilisation interministérielle impliquant les ministères de l’Éducation, de la Recherche, du Numérique, de la Justice et de l’Intérieur.
Cinq axes structurants pour une politique de référence
Le ministère de la Santé propose une stratégie d’action en cinq volets, visant à structurer une réponse nationale cohérente et durable.
-
création d’un observatoire national de la désinformation
Un Observatoire des fausses informations en santé sera institué. Il assurera la veille, l’analyse et la publication d’un baromètre périodique. Il pourra également déployer des campagnes de sensibilisation dans les médias et les espaces publics. -
mobilisation du droit européen et régulation des plateformes
Le ministère entend exploiter les leviers offerts par le Digital Services Act pour engager un dialogue avec les principales plateformes numériques. Cette concertation vise à promouvoir l’autocontrôle, sous peine d'être mentionnées dans les rapports de l’observatoire. -
renforcement de l’esprit critique et accès à une information vérifiée
Un programme d’éducation à l’information scientifique, conçu avec l’Éducation nationale, sera mis à disposition du public via des formations ouvertes en ligne (MOOC). Ces contenus visent à promouvoir les recommandations fondées sur les preuves. -
mobilisation des soignants et valorisation des acteurs de confiance
Un dispositif de labellisation permettra d’identifier les professionnels de santé actifs sur les réseaux sociaux dont les contenus sont validés. Par ailleurs, les médecins seront encouragés à signaler les fausses informations recueillies auprès de leurs patients. -
mise en place de mécanismes d’alerte en temps de crise
Un réseau de veille institutionnelle sera organisé afin de permettre une réaction coordonnée en situation d’urgence. Ce dispositif, absent lors de la crise du Covid-19, permettra aux agents publics de remonter rapidement les informations trompeuses.
Vers une gouvernance scientifique et collective
La stratégie prévoit de rassembler les grands instituts de recherche (Inserm, Institut Pasteur, Institut Curie, Imagine, Santé publique France) dans une dynamique collégiale. Cette gouvernance permettra de prendre position collectivement et de construire une riposte commune face aux fausses informations.
Encadrer les dérives : responsabilité individuelle et régulation juridique
Le ministre reconnaît l’absence actuelle de dispositifs opérationnels pour sanctionner les auteurs de contenus médicaux trompeurs. Toutefois, cette reconnaissance suscite des interrogations chez certains acteurs du monde médical. Plusieurs voix, comme celle du pharmacien hospitalier Guillaume Limousin, ont rappelé que le cadre juridique existe déjà, notamment avec l’article 223-1-2 du code pénal, introduit par la loi du 24 janvier 2022. Cet article punit de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende la diffusion intentionnelle d’informations de nature à altérer la santé.
Cette critique souligne un paradoxe : alors que le gouvernement affirme vouloir agir, il n’a pas encore activé les outils juridiques disponibles, notamment pour des cas bien documentés comme ceux liés à l’IHU de Marseille. Des parlementaires, tel le sénateur Bernard Jomier, ont interpellé l’exécutif et demandé l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, au motif que des fonctionnaires de santé auraient diffusé de fausses informations et exercé du harcèlement à l'encontre de confrères.
Le ministre affirme vouloir ouvrir un dialogue avec le ministère de la Justice. Pour ses détracteurs, cette démarche semble tardive, voire dilatoire. La question reste posée : pourquoi ne pas appliquer immédiatement le droit existant lorsqu’un danger pour la santé publique est avéré ?
Le retrait des états-unis : un contraste transatlantique
Alors que la France affirme sa volonté de structurer une réponse publique à la désinformation médicale, les États-Unis suivent une dynamique opposée. Le 16 avril 2025, l’administration américaine a supprimé le principal organe fédéral dédié à la lutte contre la manipulation de l’information étrangère : le Counter Foreign Information Manipulation and Interference (CFIMI), anciennement connu sous le nom de Global Engagement Center. Cette décision a été justifiée par le souci de préserver la liberté d’expression, mais elle suscite l’inquiétude de nombreux chercheurs et agences sanitaires, en particulier dans le contexte de résurgence de discours antivaccins ou conspirationnistes.
Cette dissolution s’accompagne également de la fermeture d’unités du FBI chargées de détecter les ingérences électorales numériques. Ce retrait américain souligne le contraste avec l’initiative française, où le ministère de la Santé affirme au contraire la nécessité d’un engagement coordonné de l’État contre les discours médicaux trompeurs. Dans ce contexte, Yannick Neuder a insisté sur le rôle que la France pourrait jouer à l’échelle européenne en tant que pays des Lumières et de la médecine fondée sur les preuves.
Limites et angles morts de la stratégie annoncée
Si la stratégie proposée par le ministère de la Santé constitue une avancée en matière de reconnaissance institutionnelle du phénomène de désinformation médicale, elle n’échappe pas à plusieurs critiques substantielles.
D’abord, de nombreuses incertitudes demeurent sur la mise en œuvre concrète des mesures annoncées. Le texte ne précise ni le calendrier, ni les moyens humains et budgétaires alloués à la création de l’observatoire, ni les critères d’attribution du label aux professionnels de santé. L’efficacité de la régulation des plateformes numériques, quant à elle, dépendra de leur bonne volonté, dans un cadre de coopération encore à construire.
Ensuite, la stratégie s’expose à une critique récurrente : celle d’un décalage entre les intentions affichées et les instruments déjà disponibles mais peu ou pas mobilisés. L’article 223-1-2 du code pénal permet depuis 2022 de poursuivre les auteurs de désinformation en santé. Pourtant, ce cadre n’a à ce jour pas été utilisé dans des cas pourtant emblématiques. Le ministre a lui-même voté contre cette disposition lorsqu’il était député, ce qui interroge sur la sincérité du revirement.
Par ailleurs, le rôle des institutions universitaires et hospitalières dans la production ou la tolérance de discours non fondés est peu abordé. Or, plusieurs affaires récentes ont montré que la désinformation pouvait émaner de structures publiques ou de professionnels jouissant d’un statut d’autorité, comme à l’IHU de Marseille. À cet égard, l’absence de réponse judiciaire ou disciplinaire claire continue d’alimenter un sentiment d’impunité.
Enfin, aucune parole de terrain n’est relayée dans cette stratégie : ni celle des soignants confrontés quotidiennement à la désinformation en consultation, ni celle des chercheurs ou patients victimes de harcèlement en ligne. Cette absence pourrait affaiblir l’adhésion à une politique pourtant fondée sur l’idée de mobilisation collective.
Une ambition européenne pour la santé fondée sur les preuves
Face à un affaiblissement du cadre international, la France entend se positionner comme référence en matière de lutte contre la désinformation médicale. En assumant un rôle moteur au sein de l’Union européenne, elle ambitionne de promouvoir une approche fondée sur la rigueur scientifique, la responsabilité collective et l’intégrité de l’information en santé.
Encore faut-il que cette volonté affichée se traduise rapidement par des actes concrets, mobilisant les outils juridiques existants, les institutions sanitaires et les professionnels de terrain. À ce prix seulement, cette politique publique émergente pourra contribuer à restaurer durablement la confiance dans la médecine fondée sur les preuves.
Descripteur MESH : Politique , Politique publique , Santé , Discours , Rôle , Lutte , Médecine , France , Confiance , Patients , Recherche , Santé publique , Face , Harcèlement , Médecins , Population , Entretien , Nature , Gouvernement , Coopération , Liberté , Voix , Temps , Diffusion , Parole , Vaccination , Démarche , Réseau