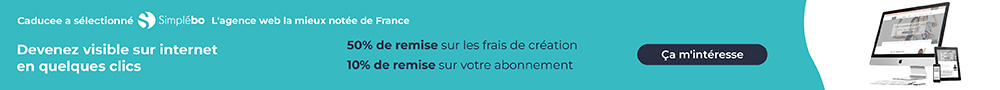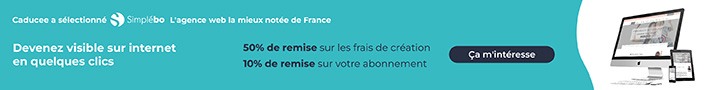Pandémies : l'OMS parvient à un accord laborieux après 3 ans de négocations

Un accord inédit pour structurer la réponse mondiale
L’élaboration de ce traité international, entamée en décembre 2021, s’inscrit dans le sillage des fractures révélées par la crise du Covid-19 : inégalités d’accès aux vaccins, absence de mécanismes de partage des données biologiques, vulnérabilité des systèmes de santé, mais aussi faible coordination des politiques sanitaires à l’échelle mondiale. Le communiqué de l’OMS précise que ce projet vise à « faire en sorte que le monde ne répète pas les erreurs du passé », en s’appuyant sur les principes de solidarité, d’équité, de transparence et de redevabilité. Il propose notamment un système de partage rapide des agents pathogènes, un accès équitable aux résultats de la recherche, et le développement de capacités de réponse réparties à l’échelle mondiale, tout en réaffirmant le rôle central de l’OMS dans la coordination de ces efforts. Il affirme également un cadre de souveraineté nationale sur les mesures de santé publique : aucun État ne pourra être contraint d’instaurer des confinements, fermetures de frontières ou campagnes vaccinales.
Autre avancée notable, la volonté de corriger certaines asymétries systémiques, notamment par un meilleur partage des bénéfices issus de la recherche, et une distribution plus équitable des produits de santé liés aux pandémies. L’accès aux agents pathogènes et aux données génétiques, la mise en commun des outils de diagnostic et des traitements, ou encore le soutien au renforcement des systèmes de santé dans les pays à faibles revenus figurent parmi les engagements formels de l’accord.
Équité et transfert de technologies : les points de friction majeurs
Si le traité est salué comme un jalon historique dans la gouvernance sanitaire mondiale, il reflète aussi les tensions persistantes entre pays du Nord et du Sud. L’un des points les plus sensibles, abordé dans l’article 11 du texte, concerne le transfert de technologies. Les pays en développement demandaient un mécanisme obligatoire, afin de garantir leur capacité à produire localement tests, vaccins ou traitements. En vain : le traité évoque une « décision volontaire mutuelle » entre les industriels et les pays partenaires.
Selon Daniela Morich, du Global Health Centre à Genève, les pays industrialisés ont clairement exprimé leur réticence à contraindre leurs industries pharmaceutiques à transférer leurs technologies vers les pays en développement. Une position jugée problématique par de nombreux observateurs, alors que la pandémie de Covid-19 avait illustré la dépendance des pays du Sud à l’égard des chaînes de production du Nord.
L’article 12, centré sur le partage des agents pathogènes (PABS - pathogen access and benefit sharing), est également critiqué pour son manque de clarté. Si le principe du partage rapide des données est reconnu, aucun cadre juridique contraignant n’est encore établi. Les détails techniques devront faire l’objet d’une annexe, négociée ultérieurement.
L’enjeu est pourtant central : comme le rappelle Mme Morich, « dans un contexte d’urgence pandémique, l’accès aux échantillons de ces agents pathogènes et aux données sur leurs génomes est fondamental. » Mais plusieurs pays à faible revenu, échaudés par les expériences récentes, craignent que leurs contributions scientifiques ne soient pas suivies d’un accès équitable aux produits développés à partir de leurs données. Lors de la pandémie de Covid-19, seulement 10 % des outils sanitaires mis au point à partir de données partagées ont été accessibles aux pays du Sud. « On institue l’injustice en norme », s’indigne German Velasquez, ancien directeur de la santé publique à l’OMS (Le Monde, 16 avril 2025).
Entre coopération et intérêts économiques, un équilibre instable
Le traité ne crée pas de nouveau fonds de financement, et ne prévoit pas de mécanismes contraignants de solidarité financière. Il s’appuie sur les dispositifs existants de coordination de fonds, dont la portée reste incertaine dans un contexte de réduction des budgets internationaux de santé. Le secteur privé, omniprésent dans la production et la distribution des produits de santé, conserve une position centrale dans l’architecture du texte, ce qui alimente les critiques sur une vision « marchandisée » de la santé mondiale.
Michel Kazatchkine, ancien directeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, souligne que la production pharmaceutique mondiale repose aujourd’hui majoritairement sur des acteurs privés, une situation qu’il juge problématique dans la mesure où elle assimile des biens de santé à de simples produits marchands.
Si les objectifs affichés — solidarité, équité, prévention — recueillent une large adhésion, leur mise en œuvre effective reste incertaine. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a néanmoins salué un « accord générationnel » et un signal fort en faveur du multilatéralisme, en soulignant qu’il s’agissait d’une étape déterminante pour faire en sorte que les erreurs passées ne se répètent pas et que les pays disposent de meilleurs outils pour faire face collectivement à une prochaine crise sanitaire.
Descripteur MESH : Santé , Pandémies , Coopération , Coopération internationale , Santé publique , Recherche , Transfert , Vaccins , Rôle , Friction , Objectifs , Face , Diagnostic , Secteur privé , Lutte , Paludisme , Santé mondiale , Revenu , Budgets , Tuberculose