Pénurie de quétiapine : un enjeu majeur pour les patients et les professionnels de santé

Les causes et les enjeux de la pénurie de quétiapine
La rupture d'approvisionnement en quétiapine est principalement due à des problèmes de production rencontrés par le fabricant Pharmathen International, principal fournisseur de nombreux laboratoires. Cette difficulté a entraîné une interruption de la distribution sur l'ensemble du territoire français. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) indique qu'aucune date de remise à disposition n'est actuellement connue.
Cette pénurie met en évidence une fragilité structurelle dans l'approvisionnement des médicaments essentiels. En cinq ans, les pénuries de médicaments ont augmenté de 80 %, soulignant la dépendance du système de santé français aux circuits internationaux de production. La situation actuelle rappelle la nécessité de repenser les stratégies d'approvisionnement pour garantir un accès durable aux traitements vitaux.
Conséquences et recommandations pour les professionnels de santé
L'interruption brutale de la prise de quétiapine peut entraîner des effets secondaires notables et accroître le risque de rechute chez les patients atteints de troubles schizophréniques ou bipolaires. Pour limiter ces risques, l'ANSM recommande aux professionnels de santé de ne plus initier de nouveaux traitements à base de quétiapine, sauf en cas d'épisode dépressif caractérisé dans le cadre d'un trouble bipolaire.
Dans les autres indications, les prescripteurs doivent privilégier des alternatives thérapeutiques. Selon l’ANSM, les recommandations sont les suivantes :
- Traitement de la schizophrénie : en première intention, l'aripiprazole ou l'olanzapine (per os), et en seconde intention, des antipsychotiques de première génération tels que la chlorpromazine, le flupentixol, l'halopéridol ou le zuclopenthixol.
- Épisodes maniaques modérés à sévères dans les troubles bipolaires : en première intention, les sels de lithium (libération immédiate), la carbamazépine, l'olanzapine et l'aripiprazole ; en deuxième intention, l’halopéridol et la ziprasidone ; en troisième intention, la chlorpromazine.
- Prévention des récidives d’épisodes maniaques ou dépressifs chez les patients ayant répondu à la quétiapine : recours à l'aripiprazole, l'olanzapine, les sels de lithium, la carbamazépine ou la lamotrigine.
- Traitement adjuvant des épisodes dépressifs majeurs résistants aux antidépresseurs en monothérapie : il est recommandé de suivre les directives de la Haute Autorité de Santé et de l’Association française de psychiatrie biologique et de neuropharmacologie.
Toutefois, certains médicaments comme la rispéridone, la palipéridone, l’amisulpride et les dérivés du valproate ne doivent pas être utilisés en substitution en raison des tensions d’approvisionnement qu’ils subissent également.
Solutions en cours d’étude
Afin d’atténuer les effets de cette pénurie, l’ANSM envisage plusieurs solutions :
- L’importation de spécialités équivalentes : les laboratoires sont sollicités pour identifier des médicaments à base de quétiapine à libération immédiate ou prolongée pouvant être importés.
- Le recours aux préparations magistrales de quétiapine : une alternative étudiée pour répondre aux besoins des patients.
- Le mécanisme de solidarité européen : depuis 2023, ce dispositif permet aux États membres de l’Union européenne de s’entraider en cas de pénurie grave.
Responsabilité médicale en cas d'arrêt brutal de la quétiapine sans substitution
Les professionnels de santé doivent être conscients des risques associés à un arrêt brutal de la quétiapine sans mise en place d'une alternative thérapeutique. Un sevrage soudain peut entraîner des symptômes aigus tels que l'insomnie, des nausées, des céphalées et des diarrhées. De plus, des événements liés au suicide ont été rapportés après l'arrêt brutal du traitement par la quétiapine.
Bien que l'article L4161-1 du Code de la santé publique concerne principalement l'exercice illégal de la médecine, il est essentiel pour les praticiens de respecter les obligations déontologiques et légales en matière de continuité des soins. Toute négligence dans la gestion de l'arrêt de la quétiapine pourrait engager leur responsabilité professionnelle.
Cette crise souligne l'urgence de renforcer la sécurité des chaînes d'approvisionnement en médicaments et d'adopter des mesures préventives pour éviter de futures ruptures. La mobilisation conjointe des autorités de santé, des industriels et des professionnels de santé est essentielle pour garantir la continuité des soins et protéger les patients les plus vulnérables.
Descripteur MESH : Patients , Santé , Soins , Continuité des soins , France , Schizophrénie , Intention , Laboratoires , Carbamazépine , Chlorpromazine , Sécurité , Sels , Lithium , Trouble bipolaire , Santé publique , Médecine , Neuropharmacologie , Directives , Sevrage , Psychiatrie biologique , Psychiatrie , Membres , Suicide , Risque , Thérapeutique , Antidépresseurs , Solutions , Médicaments essentiels , Flupentixol , Halopéridol , Rupture , Céphalées
1 réaction(s) à l'article Pénurie de quétiapine : un enjeu majeur pour les patients et les professionnels de santé

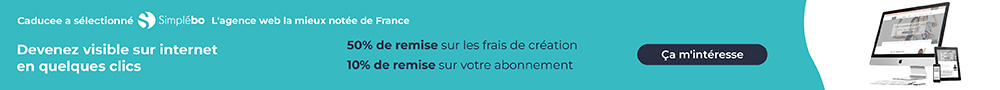
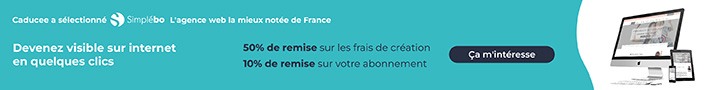
Béatrice Prevos| 07/02/2025-