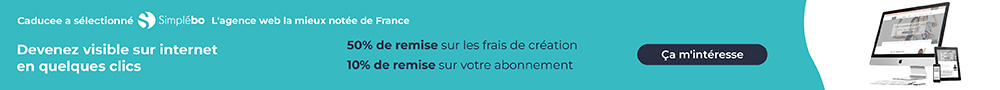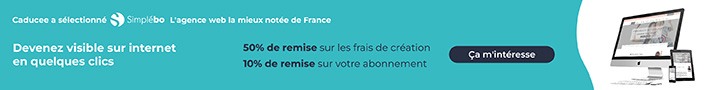Ruptures de stock de médicaments : un reflux encourageant, des tensions persistantes

Une crise marquée par son intensité et sa durée
Entre 2017 et 2023, le nombre de ruptures déclarées à l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a été multiplié par trois, une dynamique également observée ailleurs en Europe. Selon l’Agence européenne des médicaments, les signalements de pénuries ont doublé entre 2018 et 2022 à l’échelle de l’Union. La France se situe ainsi dans la moyenne haute des pays concernés, soulignant la nécessité d’une coordination renforcée.
Le pic a été atteint à l’hiver 2022-2023 : 800 présentations MITM étaient simultanément en rupture, représentant 8 % des spécialités concernées. À cette période, le déficit mensuel atteignait 8 millions de boîtes non livrées aux officines, soit jusqu’à 10 % du marché.
Depuis le printemps 2023, la situation s’améliore lentement. Fin 2024, le nombre de présentations en rupture a été divisé par deux (environ 400), mais reste élevé. Les risques de rupture, quant à eux, ont culminé à 3 370 en 2023 avant de redescendre légèrement sous la barre des 3 000 en 2024.
Des effets variables sur la disponibilité et l’accès aux traitements
Les ruptures ne provoquent pas systématiquement un effondrement des ventes. En moyenne, celles-ci chutent de 11 % en cas de rupture et de 7 % en cas de risque. Cette baisse contenue s’explique par la brièveté de nombreux épisodes (moins d’un mois pour 14 % d’entre eux) et par l’effet tampon des stocks existants chez les grossistes et officines.
En revanche, les ruptures longues ont un impact plus sévère : au-delà de quatre mois, plus de la moitié des spécialités concernées subissent une baisse de ventes supérieure à 75 % dès le troisième mois. L’accès des patients aux traitements devient alors plus problématique, notamment en l’absence d’alternative ou lorsque la tension se reporte sur d’autres produits.
La disponibilité des substituts s’est par ailleurs réduite. En 2023, on ne comptait en moyenne que 1,6 alternative par présentation en rupture, contre 5 en 2021. Cette raréfaction complique la gestion thérapeutique, tant pour les prescripteurs que pour les pharmaciens.
Des classes thérapeutiques inégalement touchées
Certaines classes de médicaments concernent plus directement des populations vulnérables, comme les personnes âgées ou les patients atteints de pathologies chroniques. La quétiapine, par exemple, un antipsychotique utilisé dans le traitement de la schizophrénie et des troubles bipolaires, est fréquemment prescrite à des patients fragiles. Les ruptures la concernant peuvent entraîner des décompensations sévères et une augmentation des hospitalisations.
Quatre classes concentrent à elles seules près de 75 % des déclarations depuis 2021 : les médicaments cardiovasculaires (30 %), ceux du système nerveux (20 %, dont le paracétamol), les antibiotiques (14 %) et les traitements digestifs (10 %).
Le reflux de 2024 est principalement lié à une amélioration dans les segments cardiovasculaire et antibiotique. D’autres, comme les anticancéreux, les immunomodulateurs et les traitements respiratoires, restent fortement touchés. Dans ces domaines, les tensions persistent en dépit des mesures mises en place.
Par ailleurs, certaines classes, comme les antibiotiques, sont particulièrement vulnérables : souvent prescrits en urgence, ils sont surreprésentés parmi les baisses de ventes les plus marquées, témoignant d’une moindre résilience logistique.
Une régulation en évolution, mais encore perfectible
Face à ces défis, les autorités ont renforcé le cadre réglementaire. Depuis 2021, les laboratoires doivent maintenir un stock de sécurité de deux mois pour les MITM destinés au marché français. La plateforme Trustmed, lancée par l’ANSM la même année, a permis une meilleure traçabilité des déclarations. Fin 2024, une première liste officielle des MITM a été publiée, identifiant 8 000 spécialités critiques.
Malgré ces avancées, plusieurs limites subsistent : causes de rupture mal identifiées, niveaux de stock hétérogènes, anticipation difficile de la demande, notamment en période épidémique. Une coordination renforcée entre acteurs reste indispensable pour prévenir les tensions.
Des outils d’intervention plus ciblés – contingentement, dérogations à l’importation, priorisation des patients – sont en cours de déploiement. Leur efficacité dépendra toutefois de la réactivité collective et de la transparence dans la circulation des données.
Source : DREES, Études et Résultats n°1335, mars 2025 – "Tensions et ruptures de stock de médicaments déclarées par les industriels : quelle ampleur, quelles conséquences sur les ventes aux officines ?"
Descripteur MESH : Thérapeutique , Pression , Rupture , Patients , Sécurité , Système nerveux , Risque , Schizophrénie , Mars , Personnes , Pharmaciens , Populations vulnérables , Laboratoires , Europe , France