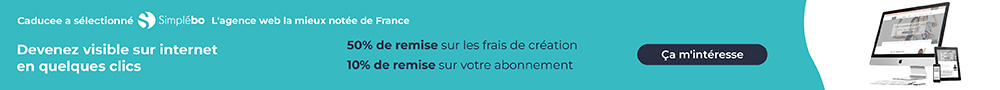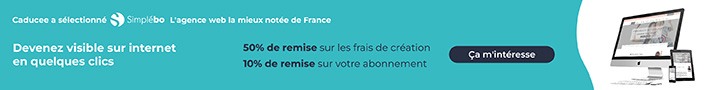Additifs alimentaires : des mélanges associés à un risque accru de diabète de type 2

Une exposition quotidienne, souvent négligée
Les aliments ultra-transformés sont devenus omniprésents dans les régimes occidentaux. Ils renferment fréquemment une variété d’additifs alimentaires utilisés pour améliorer la texture, la conservation, le goût ou encore l’apparence des produits. Jusqu’ici, la plupart des évaluations de sécurité ont été menées substance par substance, sans prendre en compte les effets potentiels des combinaisons réelles ingérées quotidiennement.
L’étude de cohorte NutriNet-Santé, coordonnée par l’Inserm, INRAE, le Cnam et les universités Sorbonne Paris Nord et Paris Cité, a analysé, sur une durée moyenne de 7,7 ans, les habitudes alimentaires de 108 643 adultes français. Grâce aux enregistrements détaillés des consommations (incluant les marques des produits), les chercheurs ont pu quantifier l’exposition à 75 additifs présents dans au moins 5 % des régimes des participants. Cinq principaux mélanges d’additifs ont été identifiés par factorisation en matrices non négatives, une méthode statistique permettant de faire émerger des profils de consommation réels et pertinents.
Deux mélanges à surveiller de près
Parmi les cinq mélanges étudiés, deux ont été associés à une incidence significativement plus élevée de diabète de type 2, indépendamment de la qualité nutritionnelle globale de l’alimentation, du mode de vie ou des caractéristiques sociodémographiques.
-
Le premier mélange inclut plusieurs émulsifiants (amidon modifié, gomme de guar, carraghénanes…), un conservateur (sorbate de potassium) et un colorant (curcumine). Ces substances sont typiques de produits comme les bouillons, desserts lactés, matières grasses et sauces industrielles.
-
Le second mélange, présent notamment dans les boissons sucrées et édulcorées, comprend des acidifiants, des colorants (caramel au sulfite d’ammonium, anthocyanes…), des édulcorants artificiels (aspartame, sucralose, acésulfame-K) ainsi que quelques émulsifiants.
Les ratios de risque (HR) associés à ces mélanges étaient respectivement de 1,08 et 1,13 pour une augmentation d’un écart-type de l’exposition. Des interactions entre les additifs ont également été mises en évidence, suggérant des effets synergiques ou antagonistes potentiels. Ces résultats rejoignent ceux de plusieurs études expérimentales in vitro et in vivo ayant déjà démontré l’impact de certains de ces additifs sur l’inflammation ou le microbiote intestinal.
Marie Payen de la Garanderie, doctorante à l’Inserm et première autrice de l’étude, souligne : « Nos travaux montrent que plusieurs additifs emblématiques présents dans de nombreux produits sont souvent consommés ensemble, et que certains mélanges seraient associés à un risque plus élevé de diabète de type 2. » Elle précise aussi que « cette approche en termes de mélange reflète mieux la réalité des habitudes alimentaires que les analyses par substance isolée ».
Vers une nouvelle approche de l’évaluation des risques
Ces résultats, bien que basés sur une étude observationnelle, renforcent les signaux d’alerte issus de la littérature expérimentale. Ils indiquent que certains mélanges d’additifs, fréquemment consommés ensemble, pourraient constituer un facteur de risque modifiable dans la prévention du diabète de type 2.
« L’évaluation des additifs alimentaires devrait désormais prendre en compte leurs interactions », plaide Mathilde Touvier, directrice de recherche à l’Inserm et coordinatrice de l’étude. Elle ajoute que ces résultats soutiennent les recommandations de santé publique visant à limiter les additifs non indispensables, notamment dans les produits ultra-transformés. Elle insiste : « La régulation actuelle repose sur une approche par substance, qui ne reflète pas les expositions multiples auxquelles les consommateurs sont confrontés au quotidien. »
Méthodologie et limites de l’étude
La force de cette étude repose sur la taille de la cohorte, la richesse des données alimentaires collectées (plusieurs enregistrements sur plusieurs années), et la méthode d’analyse des expositions utilisant les marques industrielles déclarées par les participants. L’approche statistique adoptée, fondée sur la factorisation en matrices non négatives, a permis d’identifier des profils réalistes de consommation d’additifs.
Cependant, comme le rappellent les auteurs, cette étude ne permet pas d’établir un lien de causalité. « Il est possible qu’un résidu de confusion persiste malgré les nombreux ajustements réalisés », précisent-ils. De plus, l’exposition n’a pas été validée par des biomarqueurs spécifiques, et certains additifs moins consommés n’ont pas pu être inclus dans l’analyse. La population étudiée, majoritairement féminine et sensibilisée aux enjeux de santé, pourrait aussi limiter la généralisation des résultats.
Néanmoins, les associations observées sont cohérentes avec des mécanismes biologiques déjà identifiés en laboratoire, et les résultats sont restés robustes à travers de nombreuses analyses de sensibilité. Cette étude ouvre donc la voie à des recherches complémentaires, tant en épidémiologie qu’en expérimentation, pour explorer les effets des interactions entre additifs sur la santé métabolique. Comme le conclut Mathilde Touvier : « Nos résultats soutiennent la nécessité d’une révision des politiques d’autorisation des additifs, en intégrant les effets combinés pour mieux protéger les populations. »
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004570
Descripteur MESH : Diabète , Risque , Santé , Diabète de type 2 , Paris , Expositions , Habitudes , Habitudes alimentaires , Enregistrements , Universités , Confusion , In vitro , Potassium , Sécurité , Causalité , Population , Curcumine , Vie , Littérature , Aliments , Émulsifiants , Épidémiologie , Santé publique , Recherche , Goût , Signaux , Amidon , Matières grasses , Aspartame , Incidence , Additifs alimentaires