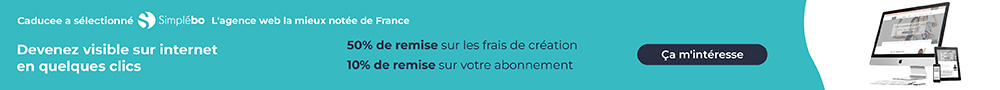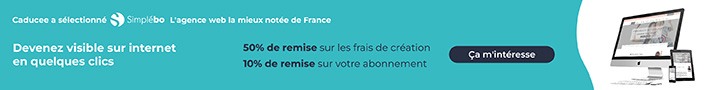Xénotransplantation hépatique : un greffon porcin fonctionne chez l’humain pendant dix jours

Une réponse potentielle à la pénurie d’organes
Face à la demande croissante en greffes de foie, les chercheurs explorent de nouvelles voies. Parmi elles, la xénotransplantation – la greffe d’organes d’animaux chez l’humain – suscite un intérêt grandissant, notamment grâce aux avancées de l’édition génétique. Si des cœurs et des reins de porc ont déjà été transplantés dans des patients humains récemment décédés, cette nouvelle étude marque une première : la greffe temporaire d’un foie porcin chez un patient en état de mort cérébrale.
Conduite par l’équipe de l’hôpital Xijing de l’université militaire de Xi’an, l’opération a consisté à greffer un foie issu d’un porc miniature Bama modifié sur six gènes afin de limiter les risques de rejet. Le foie a été implanté de manière auxiliaire, c’est-à-dire sans retirer le foie humain, ce qui a permis d’observer le fonctionnement du greffon sur une période de dix jours. Cette période correspond à la durée pendant laquelle le greffon est resté fonctionnel dans le corps du receveur, avant que l’étude ne soit volontairement arrêtée à la demande de la famille.
Une avancée dans le paysage de la xénotransplantation
La xénotransplantation n’est pas une idée nouvelle, mais elle a longtemps été freinée par les risques de rejet hyperaigu et de transmission virale. Depuis les années 1990, plusieurs essais ont été tentés, d’abord chez le primate, puis récemment chez l’humain. Les reins et cœurs de porcs génétiquement modifiés ont ainsi été implantés chez des patients en état de mort cérébrale aux États-Unis, avec des résultats variables mais encourageants.
Cette expérimentation s’inscrit donc dans une dynamique plus large visant à valider la faisabilité de la xénotransplantation chez l’humain, en conditions réelles, mais dans un cadre éthique strict. L’originalité de cette étude tient à l’organe greffé : le foie, dont la complexité fonctionnelle représente un défi bien supérieur à celui des reins ou du cœur. De plus, le recours à un greffon auxiliaire permet de limiter les risques vitaux tout en testant les fonctions biologiques de l’organe porcin dans un environnement humain.
Un foie fonctionnel et un rejet évité
Dès les premières heures suivant la reperfusion, le foie porcin a commencé à sécréter de la bile, atteignant un volume de 66,5 ml en dix jours. La production d’albumine d’origine porcine a également été détectée dans la circulation sanguine du receveur. Les enzymes hépatiques sont restées globalement stables, à l’exception d’un pic transitoire d’AST, attribué à une atteinte myocardique plutôt qu’à une défaillance du greffon.
L’analyse histologique n’a révélé aucun signe de rejet aigu. Les cellules du greffon ont montré une bonne capacité de régénération, avec une prolifération active des hépatocytes et une faible activation des cellules stellaires. La structure microvasculaire du foie porcin est restée intacte, suggérant un maintien efficace de la microcirculation.
L’équipe a également surveillé de près la réponse immunitaire du receveur. Grâce à une combinaison d’immunosuppresseurs, notamment le tacrolimus et la globuline anti-thymocyte, les réponses des lymphocytes T et B ont été maîtrisées. Toutefois, une activation retardée des lymphocytes B a nécessité l’administration de rituximab, confirmant l’intérêt de ce traitement dans les protocoles futurs.
La xénotransplantation porcine entre en phase clinique
Le succès partiel de cette greffe hépatique porcine ouvre la voie à plusieurs évolutions dans la recherche et la pratique clinique. À court terme, d'autres essais sont attendus chez des patients en état de mort cérébrale, avec pour objectif de prolonger la durée d’observation et de tester différentes combinaisons d’organes.
À moyen terme, des greffes expérimentales pourraient être proposées à des patients vivants en situation critique, en particulier comme solution temporaire en attente d’un greffon humain. Dans ce contexte, le foie porcin pourrait jouer un rôle de "pont thérapeutique", en maintenant certaines fonctions vitales.
Les recherches se tournent également vers la xénotransplantation orthotopique, qui consisterait à remplacer entièrement l’organe malade par un greffon porcin. Cette approche, plus ambitieuse, nécessitera de surmonter des obstacles supplémentaires, tant techniques qu’immunologiques.
Enfin, des efforts sont en cours pour sécuriser davantage les animaux donneurs, limiter les risques zoonotiques, et définir des protocoles d’immunosuppression plus ciblés. L'encadrement éthique et réglementaire, à l’échelle internationale, devra également évoluer pour accompagner cette transition vers une application clinique encadrée de la xénotransplantation.
Éthique, consentement et animal : les dilemmes de la xénotransplantation
La xénotransplantation, qui promet de révolutionner le traitement de l'insuffisance organique, soulève d'importants dilemmes éthiques. D’abord, l’utilisation d’un patient en état de mort cérébrale comme receveur n’est pas sans débat. Bien que les autorisations aient été obtenues et les proches informés, cette pratique interroge sur les frontières entre recherche et soin, et sur le respect de la dignité humaine.
Le statut moral des animaux est au cœur de ces discussions. Certains philosophes, comme Peter Singer, défendent une considération égale des intérêts des animaux et remettent en cause l’approche anthropocentrique traditionnelle. L’impossibilité d’obtenir leur consentement rend délicate toute justification de leur utilisation comme donneurs d’organes, même si ceux-ci sont génétiquement modifiés.
Les perspectives religieuses apportent également des éclairages contrastés. Si certaines traditions chrétiennes acceptent la xénotransplantation à condition que la dignité humaine soit préservée, la tradition juive met l’accent sur la préservation de la vie humaine, tandis que la vision islamique considère l’homme comme supérieur en dignité à l’animal. Ces références culturelles et spirituelles influencent les débats sur l’acceptabilité de ces pratiques.
Le bien-être animal et la transparence sont également déterminants. Le concept de "minimum moral standing" propose d’accorder aux animaux donneurs un niveau minimal de considération morale, en matière de conditions d’élevage, d’expérimentation et d’abattage. En parallèle, la transparence des institutions impliquées dans ces essais est essentielle pour garantir un débat public informé et éthique.
En définitive, le défi majeur est de trouver un équilibre entre le progrès médical au service des patients humains et la responsabilité éthique que nous avons envers les autres espèces vivantes.
Source : Nature, "Gene-modified pig-to-human liver xenotransplantation", 2025
Descripteur MESH : Foie , Recherche , Patients , Mort cérébrale , Éthique , Mort , Animaux , Essais , Lymphocytes , Cellules , Moral , Nature , Vie , Génétique , Reperfusion , Environnement , Régénération , Microcirculation , Circulation sanguine , Gènes , Rôle , Famille , Thérapeutique , Enzymes , Tacrolimus , Porc miniature , Bile , Hépatocytes , Lymphocytes T , Lymphocytes B , Pont