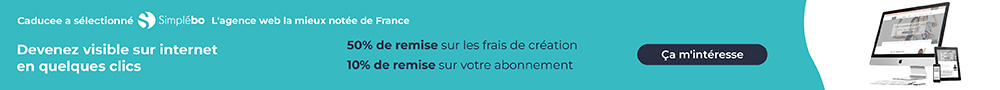Droit des victimes de violence conjugale et secret médical : un texte à l’effet dévastateur pour les victimes et source d’incertitude pour les médecins.

Voté en grande pompe, avec l’aval bienveillant et unanime de l’ordre national des médecins, ce texte est censé constituer un juste équilibre entre la protection du secret médical et la protection des victimes.
Pourtant, on va le voir, il complexifie une situation qui était simple, mais que personne ne semblait connaitre, et fragilise largement les victimes dont il consacre un inquiétant recul des droits, tandis que rien ne dit que le médecin ne soit pas, in fine, le dindon de la farce, comme d’habitude.
Reprenons.
Cette loi, du 30 juillet 2020, a adopté un article 12 libellé comme suit :
« L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° devient un 4° ;
2° Le 3° est ainsi rétabli :
“3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ;”.
De prime lecture on semble devoir se féliciter de cette modification ! Le médecin qui est témoin de violences conjugales à l’encontre d’une victime sous l’emprise de son agresseur pourra désormais en son âme et conscience faire le choix de signaler les faits au Procureur qui engagera alors, à n’en point douter, l’action publique contre l’auteur des faits.
Le texte semble devoir être d’autant plus applaudi des deux mains qu’il sauvegarde même le principe constitutionnel du secret médical, puisque le médecin n’est jamais obligé de rompre la confiance que son patient place en lui dans le sacro-saint colloque singulier.
Les victimes seraient donc mieux protégées tandis que le secret médical est préservé.
Mais… le Diable est dans les détails, ceux-là que décidément l’auteur de ces lignes va finir par croire qu’il est un des seuls à les voir !
L’article 226-14 du Code pénal a pour objet (et n’a pour effet) que d’exonérer de responsabilité pénale les médecins qui violent le secret médical lorsque l’une des circonstances prévues à ce texte se présente.
Ainsi, ne peut être poursuivi le médecin qui ferait choix de dénoncer les violences que subirait un conjoint, mais si et seulement si 1) il y a un danger immédiat pour la vie de la victime 2) si elle n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale exercée par l’auteur des violences 3) s’il s’est efforcé de recueillir le consentement de la victime.
Si ces conditions ne sont pas respectées, s’agit-il de dire que le médecin ne serait pas en droit de protéger la victime de violences en dénonçant les violences qu’elle subit et qui menacent son intégrité corporelle ?
Pour le dire autrement, que se passe-t-il si les violences que subit la patiente du médecin ne sont pas suffisamment graves pour mettre en danger immédiat sa vie (donc même si elles la mettent en danger à plus long terme), et si celle-ci n’est pas sous l’emprise morale de son conjoint ?
Une première lecture pourrait laisser penser que dans pareil cas, le secret médical est absolu, et aucune dérogation n’existe, et que le médecin a une interdiction de signalement, ne pouvant qu’inciter la victime à le faire.
Ce serait le sens des travaux parlementaires.
On lit au rapport de la commission des lois :
“La volonté de mettre un frein aux sévices au sein de la famille et d’accompagner les victimes pour briser le cycle des violences requiert la mobilisation de l’ensemble de la société. La justice ne peut agir, accorder à la victime la protection de l’État et sanctionner justement l’auteur des faits qu’à la condition d’avoir connaissance des sévices et des vexations endurés.
Pour autant, il n’est pas envisageable de remettre en cause le secret médical. Les juridictions constitutionnelle et européenne ne le permettraient d’ailleurs pas. Il importe donc de concilier ce principe avec l’objectif d’intérêt général de lutte contre les violences au sein du couple. À cette fin, la rédaction de l’article 8 comporte plusieurs garanties.”
En d’autres termes, et le sens du texte est on ne peut plus clair : la loi du 30 juillet qui autorise un signalement en l’absence d’accord de la victime ne trouve application que si et seulement si les conditions strictes posées au texte sont réunies.
A défaut, pourrait-on penser, et dans tous les autres cas, le secret médical l’emporte sur la protection de la victime.
Eh bien non !
C’est exactement l’inverse : cette nouvelle disposition, on va le voir, consacre, par un incroyable renversement de situation, une permission de déroger quand la vie est en danger, là où dans toutes les autres situations moins graves, le médecin a une obligation de dérogation.
Revenons en arrière et voyons, pour bien comprendre, quelle était la situation avant la loi du 30 juillet.
Il y avait en substance deux articles : l’article 226-13 du Code pénal, qui consacre une obligation de secret et punit sa violation…
et un article 223-6 du Code pénal selon lequel :
“Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende”
La question posée était celle de savoir quid du médecin qui savait que des violences conjugales allaient être réitérées sur une patiente, et qui peut l’empêcher au travers d’un signalement au procureur de la République ?
Pouvait-il/devait-il s’affranchir du secret médical pour signaler les faits ?
La question n’est pas théorique et la jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur le sujet.
La Cour de cassation a considéré qu’en raison de cet article, le médecin était tenu d’informer les autorités pour toutes les violences qu’il aurait pu constater sans pouvoir se réfugier derrière son obligation de sauvegarder son secret professionnel.
Un médecin attaché à un pôle gériatrique était poursuivi d’abord pour non-dénonciation de violences infligées à une personne hors d’état de se protéger, suite à des constats de violences exercées contre des pensionnaires âgés, au sein de l’établissement où il exerçait. Suite à une première décision de cassation, le fondement des poursuites avait été modifié et c’est finalement pour non-assistance à personne en danger que le médecin avait été condamné par la Cour d’appel, les juges estimant qu’il aurait dû à tout le moins informer l’encadrement infirmier et, à défaut de réaction de sa part, le directeur de l’hôpital.
Le médecin a donc formé un nouveau pourvoi où il se prévalait du secret professionnel, considérant que :
“si le directeur d’un hôpital est astreint, dans l’exercice de ses fonctions, au secret professionnel, seuls deux professionnels de santé peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations sur sa santé afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible”
Le directeur de l’hôpital n’étant pas un professionnel de santé, il ne pouvait donc être destinataire d’éléments couverts par le secret médical.
Ce raisonnement est rejeté d’une manière assez elliptique par la Cour de cassation :
“Attendu qu’il résulte de l’arrêt déféré que M. X…, médecin attaché au pôle gérontologique Nord-Sarthe, a été poursuivi pour s’être abstenu d’informer les autorités judiciaires ou administratives de mauvais traitements infligés par des membres du personnel de l’hôpital de Bonnétable envers des pensionnaires hors d’état de se protéger ; que la cour d’appel a requalifié les faits et déclaré M. X… coupable du délit d’omission d’empêcher une infraction prévue par l’article 223-6, alinéa 1er, du code pénal ;
[…]
Qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître le principe du secret médical, caractérisé les éléments constitutifs du délit précité ; d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli” (Cass. Crim., 23 oct. 2013, n° 12-80793, Bulletin criminel 2013, n° 204).
La Cour de cassation affirme donc que la juridiction a bien caractérisé les éléments de l’infraction de non-assistance à personne en danger, sans méconnaitre le secret médical.
Il ne souffrait donc plus aucun débat, à l’issue de cet arrêt sur l’obligation — et non la simple faculté — du médecin de dénoncer des faits délictueux pourtant couverts par le secret médical.
D’ailleurs, la doctrine, sous la plume par exemple du Professeur PY, agrégé des facultés de droit, disait :
“si le seul moyen efficace de porter secours consiste à transgresser le secret professionnel, l’obligation de porter secours prime”
Mais ça, c’était avant !
Car maintenant, il y a un texte spécial concernant les violences conjugales d’une particulière gravité qui mettent en péril immédiatement la vie de la victime, et celui-ci, si l’on en croit les travaux parlementaires, ne consacre pas une obligation, mais une simple faculté de signalement, sans que l’omission ne puisse être reprochée au médecin.
La Commission des lois, dans son rapport sur cet article, écrit en effet :
— la rédaction retenue autorise les professionnels de santé à adresser un signalement au procureur de la République, elle ne leur en fait pas obligation. La décision de ne pas porter certains faits à la connaissance de l’autorité judiciaire n’engagerait donc aucunement la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire du professionnel […] » (Rapport de la Commission des lois sur la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales [n° 2478], par Mme B. Couillard).
On voit donc que la loi prend exactement le contrepied de la jurisprudence et de l’analyse doctrinale évoquée plus haut : désormais, le médecin n’a plus d’obligation de signalement en cas de danger pour la vie de la victime, mais un simple droit, sachant que s’il ne le met pas en œuvre, il ne pourrait lui être reproché de ne pas l’avoir fait : ni civilement, ni pénalement, ni disciplinairement !
Les choses sont entendues : là où il y avait une obligation indistincte avant le 30 juillet, il semble, à en croire l’esprit de la loi, une nouvelle distinction à faire entre les situations où la victime est sous emprise de son conjoint et par ailleurs en danger immédiat de mort, et toutes les autres situations.
Dans le premier cas, qui est le plus grave, le médecin ne risque rien s’il ne dénonce pas, dit la commission des lois, là où dans le second cas, il risque des poursuites sur le fondement de l’article 223-6 du code pénal tel qu’interprété par la jurisprudence précitée.
La situation est totalement ubuesque et le texte a manifestement été rédigé à la va-vite, sans connaissance de l’état antérieur du droit, sans quoi on ne voit résolument pas son intérêt.
Le principe de légalité impose une lecture stricte des textes qui définissent et répriment les comportements, de sorte qu’un médecin poursuivi sur le fondement de 223-6 pourrait invoquer l’exception de 226-14 pour considérer que l’infraction n’est pas constituée.
Enfin, l’obligation de dénonciation dégagée au fronton de l’article 223-6 constitue le principe, et cette nouvelle rédaction de l’article 226-14 concerne un champ plus restreint. Il est de principe que la loi spéciale déroge à la loi générale, de sorte que si les énonciations des deux articles sont incompatibles, il y aura lieu de faire prévaloir 226-14 sur 223-6, et ce en application de principe que n’importe quel étudiant de fin de deuxième année de droit maitrise.
La question qui demeure est celle de savoir si c’est bien l’interprétation que les juridictions pourraient être amenées à consacrer, mais c’est en tout cas celle qui est la plus cohérente avec les principes généraux du droit pénal.
Or, une telle lecture serait alors destructrice pour les victimes : le médecin qui, auparavant, devait dénoncer, aurait désormais le choix pour autant que la victime serait sous emprise et risquerait immédiatement sa vie.
Plus grave encore, le choix du médecin ne pourrait absolument pas être remis en cause par le juge !
En caricaturant à l’extrême on pourrait ainsi imaginer le cas d’un médecin qui, suite au décès d’une victime, serait poursuivi. Il pourrait alors alléguer avoir été témoin des violences extrêmement graves subies par la victime, et avoir eu pleinement conscience que cette dernière était sous emprise, mais pourtant avoir fait le choix délibéré, de ne rien dénoncer au procureur, pour par exemple, ne pas compromettre les enfants.
Le Juge ne pourrait lui reprocher ce choix.
Mais si à l’inverse, la victime ne succombe pas, et que le médecin est poursuivi par le parquet pour ne pas avoir dénoncé les violences, il risquerait d’être condamné pour s’être abstenu !
En outre cette situation pourrait amener à un terrible paradoxe pour la victime. En effet, on l’a dit, l’article 226-14 n’est applicable que si certains critères limitativement énumérés sont remplis, et notamment, les violences doivent menacer sa vie.
Un médecin poursuivi pourrait, par pure stratégie, affirmer que les violences étaient extrêmement graves et menaçaient la vie de la victime pour se prévaloir de la lecture dévoyée de l’article 226-14 dénoncée ici, tandis que le Procureur serait alors contraint de minimiser l’impact de ces violences pour sortir des conditions de l’article 226-14 et obtenir une condamnation du médecin.
Et encore, on peut douter que cette stratégie puisse s’avérer payante puisque, toujours selon le texte, il appartient au médecin d’apprécier « en conscience » la gravité des violences et l’emprise sous laquelle se trouverait la victime.
L’emploi d’un tel terme semble induire que le juge ne pourrait en aucune façon être compétent pour apprécier si le médecin a bien ou mal apprécié les différents facteurs.
Dans sa lecture la plus radicale, le nouveau texte de l’article 226-14 neutralise une jurisprudence protectrice des droits des victimes, ce que l’on peut regretter, tandis que dans sa version la plus modérée, cet article ne sert, purement et simplement à rien.
Quelle que soit l’interprétation qu’il faille faire de ce texte, une chose est certaine : son adoption n’aura fait que compliquer une situation déjà passablement délicate, tant sur le plan juridique que sur le plan humain, et dans laquelle l’état du droit antérieur que manifestement ni l’ordre national des médecins, ni le législateur ne semblaient connaitre, était largement suffisant.

SELARL DI VIZIO
130 bis avenue Charles de Gaulle,
92200 NEUILLY sur SEINE
Tél : 01 78 82 00 15
http://www.cabinetdivizio.com/
Descripteur MESH : Médecins , Violence , Violence conjugale , Vie , Santé , Lecture , Connaissance , Jurisprudence , Risque , Conscience , Éléments , Continuité des soins , Membres , Lutte , Adoption , Crime , Soins , Confiance , Famille , Mort